Ndar ou Saint-Louis du Sénégal a toujours joué un rôle de premier plan dans le rayonnement de l’Islam dans notre pays. Deux auteurs, Dr Cheikh Tidiane Fall, enseignant à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et Mouhamadoul Mokhtar Kane, consultant en communication, viennent de publier aux éditions Albouraq un premier tome d’un ouvrage sur les érudits musulmans de Saint-Louis. Plusieurs oulémas et figures religieuses de la vieille ville ont été mis en lumière à travers des notices biographiques retraçant leur vie et leurs œuvres. Leurs itinéraires, leur héritage moral et spirituel, leurs productions intellectuelles, leurs activités religieuses et sociales ainsi que leur pensée faite de sagesse et d’humanisme ont été revisités. Leurs origines, leur parcours, leurs humanités, leur personnalité ont été relatés et des témoignages sur eux ont été recueillis.
Les notices biographiques proposées constituent un échantillon assez représentatif des époques et des générations qui se sont succédé durant trois siècles dans l’ancienne capitale du Sénégal et de l’A.O.F (Afrique Occidentale Française). Les érudits les plus emblématiques de la ville sont présents dans cet ouvrage dont le contenu sera étalé sur plusieurs tomes.
« Réaliser une anthologie, c’est d’abord effectuer un travail sur la mémoire, sur l’histoire et, par conséquent, sur le patrimoine. Plus précisément, le patrimoine immatériel qu’il importe de sauvegarder et de valoriser, au regard des richesses et valeurs inestimables qu’il comporte. Réaliser une anthologie, c’est aussi partager un héritage civilisationnel avec tous ceux qui s’intéressent à l’Islam, à sa culture et à ses apports à la construction de notre identité. Des pionniers ont marqué de leur empreinte leur époque en développant un leadership intellectuel et religieux et en apportant beaucoup à la communauté musulmane. Revisiter leur glorieux passé, à travers les résumés de leur biographie, permet de construire des repères qui éclairent le présent et nous projettent vers l’avenir. Plus nous regardons loin dans notre passé, plus nous regarderons loin dans notre avenir. Un avenir qui, justement, ne doit pas être que matériel.
Si aujourd’hui la civilisation occidentale est en panne, c’est parce qu’elle s’est jetée à corps perdu dans le matérialisme et s’est amputée d’une dimension essentielle de la vie humaine, à savoir, la spiritualité. Or, notre société est, aujourd’hui, dangereusement en proie à l’esprit matérialiste qui risque de triompher si l’on n’y prend garde. Elle est aussi menacée par les errements dogmatiques et doctrinaires au sein de la Umma islamique. Des parades et des remparts existent pour se prémunir de telles menaces, parmi lesquels, la revivification d’un héritage riche constitué de valeurs authentiques transmises généreusement par des hommes dont nous évoquons ici la vie et l’œuvre et qui ont pour nom : foi en Dieu, piété, dévotion, sagesse, humilité, sobriété, droiture, résilience face aux difficultés de la vie, passion pour la quête permanente du savoir, partage des connaissances, abnégation dans le travail d’éducation, fraternité humaine, amour du prochain, tolérance, solidarité envers les plus démunis, etc.(…)
Ville aux facettes multiples, la proximité du Fouta, du Walo et de la rive droite de la Mauritanie participa à faire de l’ancienne capitale du Sénégal un foyer islamique de tout premier plan. Mais, il convient de rappeler qu’à la faveur des diverses guerres saintes[[1]]url:#_ftn1 du XVIIIè siècle qui ont eu lieu au Fouta Djallon et au Fouta Tooro, d’une part, et des migrations internes du Trarza voisin, d’autre part, le champ intellectuel saint-louisien s’est fortement étoffé de talents nouveaux. L’augmentation considérable du nombre de lettrés et la dissémination du savoir islamique constituent une des résultantes de ces divers prosélytismes.
L’effervescence religieuse dont Saint-Louis a été le théâtre, durant la période couvrant la seconde moitié du dix-neuvième jusqu’au milieu du vingtième siècle, s’expliquerait, en partie, par cette synergie de créativité et d’effusion culturelle et mystique[[2]]url:#_ftn2 provenant d’intellectuels multidimensionnels qui ont eu à marquer de leur empreinte la vie socioreligieuse de la ville. Qui sont ces hommes et femmes qui ont porté le flambeau de la foi et de la vie religieuse de Saint-Louis ? Ils sont imams, cadis, maîtres coraniques, jurisconsultes, théologiens, soufis, dévots, ascètes, guides confrériques, prédicateurs, poètes et écrivains qui, parallèlement à leurs activités socioreligieuses, ont exercé des métiers de commerçants, de traitants, d’opérateurs économiques, d’agriculteurs, d’artisans, de diplomates, d’enseignants, de traducteurs, d’interprètes, de fonctionnaires de l’Administration coloniale et postcoloniale. (…)
Que l’on soit natif de la ville ou Saint-louisien d’adoption, c’est-à-dire, originaire du Walo, du Ndiambour, du Cayor, du Baol ou du Saloum avec sa langue wolof, du Fouta avec sa langue pulaar, de la Mauritanie avec sa langue arabe et son dialecte Hassaniyya, le « langage » lui, reste le même : vivifier la parole éternelle d’Allah malgré, parfois, quelques rivalités sourdes ou affichées pour le leadership religieux ou pour le choix des imams de certaines mosquées et malgré la diversité des sensibilités au niveau de l’expérience religieuse et confrérique. Ce qui démontre, encore une fois, le caractère intemporel du message islamique, ainsi que son contenu transhistorique. À travers les notices biographiques des érudits de Saint-Louis, se dégage un certain nombre de constantes qui conditionnent et reflètent, à la fois, une vision du monde : une mentalité commune forgée par la parole révélée et les Traditions inspirées.
De son vrai nom El Hadj Mokhtar Seck, on a très souvent tendance à le confondre avec son fils Doudou Seck Ibn Bou El Mogdâd. Celui-ci a, en fait, hérité du sobriquet de son père, à telle enseigne que nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à faire la distinction entre le père et le fils, ou croient qu’il s’agit d’une seule et même personne. Pour éviter donc toute confusion, nous utiliserons les appellations Bou El Mogdâd Père et Bou El Mogdâd Fils. Ce dernier est également connu sous le nom de Doudou diminutif de Mouhamadou qui est son véritable prénom. Bou El Mogdâd est la déformation d’Ibn Miqdâd qui signifie « Le fils de l’homme à la taille bien faite ». Ce surnom serait certainement d’origine maure, tant l’étroitesse des relations de sa famille avec les grandes familles de la Mauritanie était réelle.
Bou El Mogdâd Père, qui était également connu sous le nom de Mame Ibnou, vit le jour vers 1826 à Saint-Louis. Fils d’Abdoulaye Cheikh Seck un marabout traitant et de Yacine Gaye, son éducation s’effectuera en Mauritanie chez les Awlâd Daymân[[1]]url:#_ftn1 qui assureront également celle de son fils Doudou. De retour à Saint-Louis, il remplira les fonctions d’interprète principal dans l’Administration coloniale pendant vingt ans. Il exercera en même temps la fonction de rédacteur et de traducteur de l’arabe auprès du Gouvernement du Sénégal[[2]]url:#_ftn2 . Il est cité en exemple pour ses qualités à concilier son attachement profond à l’Islam et sa loyauté envers l’Administration coloniale. Il deviendra, par la suite, Cadi ou chef de la justice musulmane. Il remplace à ce poste Hamath Ndiaye Hanne dont il est le beau-frère. Ci-dessous un jugement qu’il a rendu en tant que Cadi.
Ce 27 avril 1880 par-devant nous le Cadi Bou El Mogdâd, assisté du greffier, avons siégé à l’effet de juger le litige survenu entre le sieur Kamb et sa femme Bobo S.
Cette dernière se plaint que son mari lui porte préjudice en la frappant et en l’insultant.
Le mari interrogé, a reconnu exacts les dires de la femme. Par conséquent, les torts causés à cette dernière sont bien constants ; mais étant donné qu’elle préfère reprendre la vie commune avec son époux, nous les avons réconciliés.
Grand chantre de la Murîdiyya, Cheikh Abdoul Karim Samba Diara Mbaye est l’un des premiers compagnons de Cheikh Ahmadou Bamba et l’un de ses disciples les plus célèbres. Né vers 1868 à Massar Diop, près de Coki, il est le fils de Cheikhou Ahmadou Mbaye et de Sokhna Ndack Kane Niang. Il est issu d’une grande famille religieuse qui a eu à jouer un rôle important dans la gestion et le fonctionnement de l’Université de Coki. Il est le cadet d’une fratrie composée de ses deux frères, Cheikh Saadièye et Alioune ainsi que de sa sœur Arame Boye Mbaye. Sa mère, une femme très vertueuse, avait de grands dons de voyance et possédait cet art divinatoire de prédire les événements futurs.
Cheikh Samba Diara apprit d’abord le Coran sous le toit familial et fut confié, ensuite, à Serigne Coki, Ndiaga Issa Dièye qui lui approfondit ses connaissances du livre saint. Il commença aussi à s’exercer auprès de lui à l’écriture poétique. À 15 ans, il paracheva ses études auprès de son homonyme, Cheikh Samba Diara Diop et auprès de Serigne Ibrahima Diagne « Ndiagne ». Ecrivain précoce, il composa un poème à partir de la Ṣalât âlâ Nabi (Prière sur le Prophète, PSL) qu’il montra à Cheikh Bou Kounta de Ndiassane. Celui-ci lui aurait dit : « celui qui sera ton guide s’appelle Ahmadou. Il n’a pas encore commencé à faire parler de lui. Il faudra encore patienter. »[[1]]url:#_ftn1 Il se rendit aussi à Tivaouane à la rencontre de Cheikh El Hadj Malick Sy qui lui offrit un exemplaire de son œuvre biographique du Prophète (PSL), Ḫilâṣ a-dzahab ou L’or décanté. Pour lui témoigner sa gratitude, Cheikh Samba Diara lui donna un manteau en guise de cadeau[[2]]url:#_ftn2 .
Il vint ensuite à Saint-Louis, y exerça le métier de vendeur au marché de Ndar-Toute[[3]]url:#_ftn3 et y épousa en troisième noce, Sokhna Anta Codé Gningue. Mais, il n’eut pas d’enfant de cette union. De ses deux autres mariages, il eut une fille dénommée Fatima Zahra avec sa première épouse Sokhna Maty Bombo Ndiaye et deux fils avec sa deuxième, Sokhna Fatou Talla Ndiaye. Il s’agit de Mouhamadou Moustapha, homonyme du premier khalife des Mourides et Mbacké Samba Diara, décédé en 1990[[4]]url:#_ftn4 . Dans la vieille ville, il y retrouva son frère Cheikh Saadièye Mbaye qui l’amena auprès du fondateur de la Murîdiyya. Ce dernier sera son guide spirituel. Il l’accompagnera dans son exil en Mauritanie et le retrouvera par la suite à Diourbel. Cheikh Samba Diara demeura à Saint-Louis jusqu’à la fin de ses jours en 1917. (…)
Il est un monument des sciences islamiques dont Saint-Louis peut s’enorgueillir. Il est né en 1875 à Saint-Louis de Ndiack Ndiaye et de Fatou Seck. On l’appelait familièrement Ould Ndiack, surnom d’origine Maure. Il a fait l’essentiel de ses études à Ndiamère, en Mauritanie, où il séjourna pendant 8 ans. Un savant nommé Al-Habib était l’un de ses maîtres. Il apprit dans ce pays les disciplines religieuses, la langue arabe et l’arithmétique. Son érudition et sa réputation de grand savant dépassaient nos frontières. Avant d’aller en Mauritanie, il avait auparavant appris le Coran près de Diama, puis s’était rendu à Boghé (Mauritanie) pour un bref séjour.
C’est en Mauritanie qu’il a commencé à enseigner en 1901. Ensuite, il ouvrit son daara à Saint-Louis. Son école pouvait être considérée comme une véritable université populaire. Les disciplines les plus diverses y étaient enseignées : Coran, droit islamique, tawhid, prosodie, grammaire, hadiths, rhétorique, etc. D’illustres figures religieuses l’ont fréquenté pour bénéficier de ses enseignements. Parmi elles, l’on peut citer Serigne Abbas Sall, Serigne Mansour Sy, fils de Cheikh El Hadj Malick Sy, Serigne Mamoune Ndiaye, El Hadj Bachir Samb, Serigne Moustapha Mbacké, fils de Serigne Massamba Mbacké frère de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Ahmed Fall.
En poésie, cet homme faisait figure d’autorité. La preuve, ses élèves lui soumettaient leurs œuvres pour correction et des manuscrits venants de toutes parts, du pays et même du Maroc, lui étaient envoyés pour qu’il y jette un regard critique. En plus de cela, il excellait dans l’irtjâl, c’est-à-dire, cette faculté extraordinaire d’improviser des vers.
On aime souvent raconter les anecdotes suivantes relatives à son pèlerinage à la Mecque. En effet, il eut dans un premier temps l’intention d’accomplir ce pilier de l’Islam en 1912. Il réunit alors tous ses parents et s’enquiert de leurs conditions de vie. Certains parmi ceux-ci évoquèrent des problèmes auxquels ils étaient confrontés ; il renonça alors au voyage et leur distribua l’argent qu’il avait économisé pour s’acquitter de son devoir religieux. Quelques années après, il renouvela encore son intention et refit la même chose. Il ne se rendra à la Mecque qu’en 1929. Devant le tombeau du Prophète (PSL), il improvisa un poème long de 32 vers à la gloire de l’Envoyé d’Allah. Ces actes posés donnent une large idée de la piété de l’homme, mais aussi de sa noblesse d’âme. Il était aussi d’une grande simplicité et d’une rare modestie.
Tenant son commerce tout en enseignant, Ould Ndiack fut également un faqîh ou jurisconsulte de grande renommée. Son œuvre en droit islamique témoigne de son érudition dans ce domaine. Il a inscrit à son actif deux célèbres ouvrages de grande qualité. Le premier, que l’on peut facilement trouver dans la bibliothèque de la plupart des marabouts à Saint-Louis, a trait aux partages successoraux et s’intitule ainsi : Zawraq Al-ẖâ‘iḍ fî ’ilm al farâ‘iḍ ou l’embarcation de celui qui s’investit dans la science de l’héritage. C’est une œuvre qui a été rééditée au Maroc, pour la troisième fois, sur ordre du roi Hassan II en 1986. Le deuxième est titré : Barq al-ġuyûṯ al-munbitât ou L’éclair des pluies abondantes porteuses de germinations. Il comporte trois réponses à des questions de jurisprudence et deux remarques en vers sur la lecture et la prononciation du Coran. La première partie juridique est suivie de huit chapitres consacrés à des conseils adressés aux associations islamiques.
Quant à ses œuvres poétiques, elles n’ont pas été rassemblées dans un recueil. Elles portent sur la panégyrie, la religion et la sagesse. Parmi ses poèmes disponibles, on peut citer les suivants : un poème de 37 vers constituant une supplique ; un poème de 36 vers chantant les louanges du Prophète (PSL) ; un poème de 6 vers faisant les éloges de Cheikh Ahmadou Bamba.
Son style dense et fait apparaître des connaissances sûres de la langue arabe et une virtuosité dans l’expression.
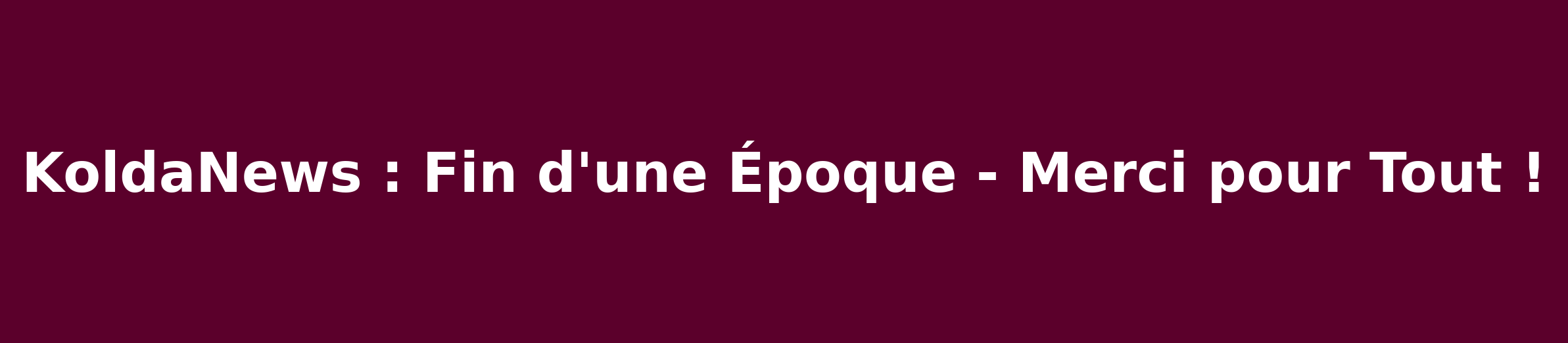

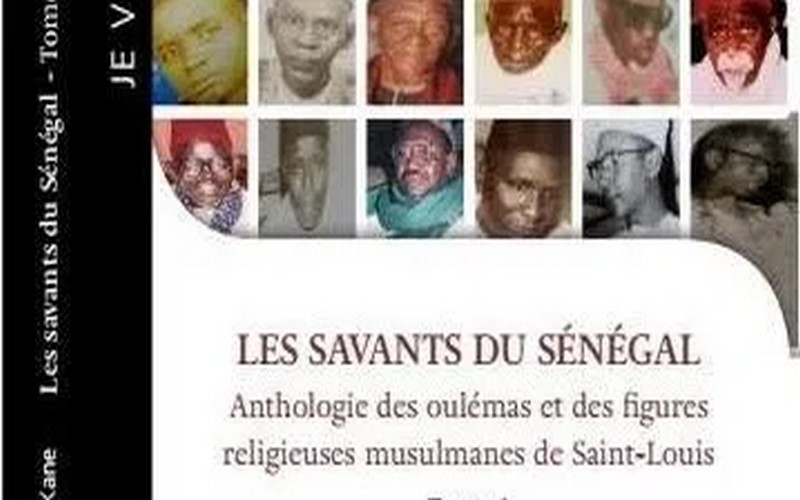
Laisser un commentaire